L’actualité de la RSE en brèves. Cette semaine, à quelques jours de la présentation de la loi omnibus qui doit réviser la CSRD et le devoir de vigilance, on se penche sur les dernières orientations connues et ce que pensent vraiment les entreprises du reporting de durabilité. On fait aussi le point sur plusieurs lois adoptées comme celle sur les PFAS ou la loi d’orientation agricole, par le Parlement français.
Le fil de l’info
🛢️Portes tournantes. Un haut dirigeant de TotalEnergies vient d’être nommé au Quai d’Orsay, relève Le Monde. Le vice-président de la performance environnementale et sociale du pétrolier va devenir directeur Afrique et Moyen-Orient au ministère des affaires étrangères. Un système d’aller-retours qui montre de nouveau la proximité entre la multinationale et la diplomatie française…💥La guerre en Ukraine a entraîné plus d’un million de victimes (morts et blessés), c’est plus que tout autre conflit sur terre actuellement. Les conséquences sont également environnementales souligne une étude menée par l’Initiative on GHG Accounting of War. Le conflit a émis 200 MtCO2 de gaz à effet de serre, soit les émissions annuelles combinées de l’Autriche, de la Hongrie, de la République tchèque et de la Slovaquie. 🆘En 2024, 856 associations ont été concernées par des procédures collectives (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), un triste record depuis 2018. Ce sont notamment « les arbitrages budgétaires des collectivités » qui mettent en péril ces structures privées à but non lucratif, selon Le Monde. Or elles emploient 11 % des salariés en France. 👩🎓Intégrer l’environnement dans son cursus scolaire, c’est un signe que « l’établissement propose des enseignements actualisés et en phase avec les défis contemporains », pour le trois quart des étudiants interrogés dans le baromètre « les jeunes et l’intégration des enjeux environnementaux par les écoles« réalisé par Opinion Way pour Mines Saint-Etienne. Elles garantissent aussi de meilleurs débouchés dans le monde du travail, selon 63%. 📊97 % des cadres affirment que les rapports sur le développement durable constitueront un avantage commercial d’ici deux ans, et 96 % des investisseurs reconnaissent qu’ils renforcent les performances financières, selon le rapport 2025 Executive Benchmark Survey de Workiva
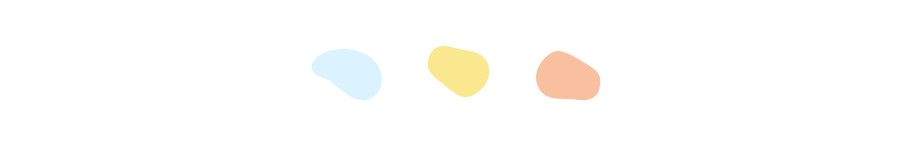
CSRD, Devoir de vigilance : que prévoit l’omnibus qui sera dévoilé le 26 février ?
Les points de révision qui ont fuité laissent craindre un détricotage profond des textes
A l’approche de la communication autour de la loi omnibus qui doit ouvrir la révision de textes phares du Green Deal pour les entreprises, les leaks se multiplient. La dernière version du projet publiée par Contexte, donne quelques pistes. Qui seront confirmées ou pas – tant les négociations restent intenses- le 26 février dans une communication réalisée par Stéphane Séjourné, vice-président exécutif pour la prospérité et la stratégie industrielle de la Commission européenne et la Présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Pour la CSRD, c’est notamment une restriction du nombre d’entreprises qui est prévue à travers le relèvement des seuils : seules les entreprises de plus de 1 000 salariés et réalisant plus de 450 millions d’euros de chiffre d’affaires seront concernées (contre 250 salariés auparavant). Cela ferait passer le nombre d’entreprises concernées en Europe de 50 000 à 4 000. Dont 700 en France, soit 5 fois moins que le nombre d’entreprises soumises à la publication d’une DPEF, selon le consultant de R3 Ludovic Flandin. Les demandes d’information tout au long de la chaîne de valeur seraient également retsreintes et les normes sectorielles abandonnées. Régulièrement évoqué, l’abandon de la double matérialité n’est pas mentionné dans le texte, du moins à ce stade. Sur la CS3D, le détricotage de cette législation qui avait déjà eu du mal à être adopté, est encore plus massif. L’obligation de diligence raisonnable serait limitée aux opérations propres, aux sous-traitants et aux partenaires commerciaux directs, au lieu de s’étendre à toute la chaîne de valeur; le régime général de responsabilité civile serait supprimé, la notion de « parties prenantes » restreinte; et la mise en œuvre des plans de transition climatique ne serait plus obligatoire. La taxonomie verte n’est pas mentionnée dans l’ébauche mais elle pourrait devenir volontaire selon plusieurs sources. Quant au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF ou CBAM), il doit aussi faire l’objet d’une révision mais dans un texte à part.
CSRD : ce que veulent vraiment les entreprises ?
Si les organismes patronaux sont vocaux sur ce que devrait être ou pas la CSRD, qu’en pensent vraiment les entreprises concernées ? C’est ce qu’ont cherché à savoir Makesense et une vingtaine de cabinets de conseil sur la RSE à travers une consultation des dirigeants et de cadres concernés par la directive européenne. 294 DG, directeurs et directrice financier, RSE ou des risques, impliqués dans la préparation de la CSRD pour leur entreprise (ETI et PME majoritairement) ont répondu sur la période du 10 au 18 février. Résultat: 80% des grandes entreprises se disent prêtes à publier et 75% des PME et ETI concernées disent être en cours de préparation (y compris pour la double matérialité). 80% d’entreprises se disent satisfaites ou très satisfaites du cadre actuel mais soyons honnête, 67% demandent plus de soutien ou de simplification. Lesquelles ? Des guides et normes sectorielles pour simplifier la mise en place de la CSRD, la mise en place d’un guichet unique avec d’autres obligations type BEGES et des subventions/aides ciblées sur le modèle du Diag décarbonation. Moins de 2% demandent la suppression de la direction ou de la double matérialité, son principe phare. Mais 52% souhaitent une réduction du nombre de data points à divulguer et 48% un allègement des indicateurs narratifs et des règles d’audit. Enfin, pour plus d’équité, un tiers souhaitent avancer le calendrier pour les entreprises extra-européennes pour l’aligner sur celui des européennes.
L’Espagne et le Danemark, rares pays soutiens du Green Deal
A ce stade, peu de pays ont montré un soutien franc et clair à la CSRD ou CS3D. L’Espagne fait cependant partie de ceux-là. Sa position a été publiée dans El Pais. « Nous apprécions grandement la contribution de la directive CSRD (…). Ces normes sont essentielles non seulement pour mobiliser ces investissements, mais aussi pour s’assurer qu’ils sont orientés vers les technologies, les produits et les services nécessaires à la transition ». Quant à la directive sur le devoir de vigilance, « elle garantit des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’UE, en renforçant notre marché unique et en surmontant la fragmentation de la réglementation », explique le gouvernement espagnol dans le quotidien. Même son de cloche du côté du Danemark.
La plateforme RSE prend (enfin) la parole sur l’omnibus
Jusqu’à présent, la plateforme RSE, une instance de concertation multipartites française placée auprès du Premier ministre qui réunit les professionnels, académiques, syndicats et ONG, ne s’était pas exprimée sur la révision en cours de la CSRD/CS3D. Elle vient enfin de prendre la parole pour défendre le Pacte Vert. « La priorité d’éventuelles modifications doit consister dans l’amélioration de l’opérationnalité, de la lisibilité et de l’adéquation des points de reporting avec les défis réels des entreprises sans faire régresser l’élan transformateur de leur architecture » et non à « mettre en cause les piliers législatifs et réglementaires ».
Réseau : 100 personnalités qui font la transition
Christophe Guérin, directeur général de Nexans, Thomas Breuzard, Directeur du modèle permaentreprise de Norsys, Elizabeth Tchoungui, directrice exécutive RSE d’Orange, Marguerite Laborde, directrice de Mustela, …voici quelques unes des personnalités identifiées dans le palmarès Les 100 qui font la transition. Sans prétention à l’exhaustivité, « il met en avant des personnalités qui agissent au quotidien, à leur échelle et dans leur secteur d’activité, pour faire bouger les lignes ». A consulter ici.
RH : un guide pour faire évolution la fonction publique à l’aune de la transition écologique et sociale
Comment faire évoluer les compétences et métiers des agents publics à l’aune des transitions écologiques et sociales ? Comment intégrer la transition écologique dans le dialogue social ? Ou encore quelles actions mettre en place pour améliorer l’attractivité de l’emploi public, en valorisant l’engagement écologique des agents ? Vous trouverez les réponses dans le guide « Les directions RH au service de la transition écologique« , 81 pages rédigées par des membres du réseau Le Lierre et Une fonction publique pour la transition écologique. Un enjeu essentiel pour la transition écologique sachant que l’on compte 5,6 millions de fonctionnaires.
La COP16 sur la biodiversité reprend à Rome
Suspendue depuis la session de novembre de Cali (Colombie), la COP16 va reprendre à Rome du 25 au 28 février. Au cœur des discussions : le cadre pour le financement de la biodiversité au niveau international et le mécanisme d’évaluation des progrès réalisés par rapport aux objectifs pour 2030 fixé par le cadre mondial de Kunming-Montréal. C’est la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier Runacher, qui y représentera la France. Le nouveau texte propose une réforme d’ici 2030 des flux financiers pour sauvegarder la nature. Ils doivent atteindre 200 milliards par an d’ici 2030, dont 30 milliards des pays riches. Mais on ne sait pas encore via quel type de véhicule financier.
Outil : un guide pour mieux intégrer la nature dans son entreprise
Comment mieux intégrer la nature dans son entreprise, sa stratégie et sa gouvernance ? Alors que des expériences commencent à voir le jour en France (voir notre article sur Norsys) et à l’étranger, B Lab avec le Earth Law Center viennent d’éditer un guide pratique pour accompagner les entreprises dans ces démarches encore pionnières. Nature conseillère, actionnaire ou administratrice, il existe différents modèles en fonction de votre maturité et vos ambitions. Le guide vous en explique les subtilités et vous donne la marché à suivre dans le contexte juridique français.
Métiers: 53% des professionnels du marketing et de la com se disent être prêts à quitter leur poste actuel si la RSE n’était pas intégrée
La grande majorité des professionnels du marketing et de la communication voient le fait de porter un rôle sociétal et/ou environnemental comme une question de survie pour leur marque. Ils n’ont plus peur de communiquer sur leurs engagements (93%contre 66% en 2020) et ne voient plus le bashing comme inévitable (28% contre 41% en 2020). D’ailleurs, le greenwashing, c’est le fait des autres, pas de leur entreprise ! 😉 C’est l’un des enseignements de la cinquième édition du Baromètre de l’engagement des marques réalisé par Cision pour le Club des Annonceurs auprès de 436 professionnels. Recueillies entre juillet et septembre 2024, les réponses seraient-elles différentes aujourd’hui face au backlash écologique montant ? Un point notamment interpelle : malgré une année portée par les JOP (Jeux Olympiques et Paralympiques) 2024, l’inclusion et la diversité baissent de 7 points et arrivent quatrième au classement des engagements, comme un écho aux politiques DEI de plus en plus décriées aux Etats-Unis (voir notre article). Autre point intéressant : 84% des professionnels interrogés assurent que la RSE fait partie de leur périmètre de responsabilité et 53% disent être prêts à quitter leur poste actuel si cela n’était pas le cas. Chiche ?
Réglementation: les lois sur la transition écologique et sociale adoptées ou en cours d’examen en France
PFAS : un pas vers une réglementation plus stricte des polluants éternel
C’est une loi qui devrait faire date. Après un long parcours législatif, la proposition de loi portée par le député écologiste Nicolas Thierry, a été définitivement adoptée le 20 février. Elle vise à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées plus connus sous le nom de PFAS ou de polluants éternels. A partir de 2026, la fabrication, l’importation et la vente de produits contenant des PFAS seront ainsi interdites dans trois catégories de biens de consommation : les cosmétiques, les textiles d’habillement (à l’exception des vêtements de protection pour les professionnels de la sécurité et de la protection civile) et les farts de ski. D’ici à 2030, l’interdiction s’étendra à tous les textiles. Mais les ustensiles de cuisine, qui ont fait l’objet d’une bataille de lobbying acharnée, notamment de certaines entreprises comme SEB, ne sont pas concernés. Pour Hélène Duguy, experte juridique chez ClientEarth, « cette loi présente des lacunes indéniables » en se limitant à nombre restreint d’articles de consommation et sans aborder les utilisations industrielles (ex :automobile et électronique). « Néanmoins, la France est l’un des premiers pays à agir face à ce qui est à la fois une crise de santé publique et une crise environnementale ». Une restriction des PFAS à l’échelle de l’UE est en cours mais la proposition de la Commission européenne n’est pas attendue avant 2027.
Une loi d’orientation agricole qui consacre des régressions environnementales
Conçue initialement pour répondre à l’enjeu du renouvellement des générations et au défi de la crise climatique, la la Loi d’orientation agricole, définitivement adoptée ce 20 février, apparaît davantage comme une réponse à la contestation agricole qui gronde depuis l’hiver 2024. Si elle confère à l’agriculture un caractère d’« intérêt général majeur », elle est extrêmement critiquée au regard des nombreux reculs environnementaux qu’elle induit. Sous le poids de la FNSEA et de la Coordination rurale, la loi intègre notamment le principe « pas d’interdiction sans solution » qui vise à empêcher l’interdiction des pesticides sans alternative. Le Sénat a également introduit une notion de « non régression de la souveraineté alimentaire » mis sur le même plan que la « non régression en matière de protection de l’environnement« . Autre gros point de crispation: la large dépénalisation des atteintes à l’environnement avec des amendes ne dépassant pas les 450 € même en cas d’infraction grave…Enfin les termes d’agro-écologie, d’agroforesterie et même de « transition climatique et environnementale » ont disparu du texte. Bref, un très mauvais signal pour l’avenir de notre agriculture, de notre alimentation et de notre environnement.
A venir : la loi anti-fast fashion et celle sur les ultra-riches
Autres propositions de lois qui doivent poursuivre leur chemin au Sénat dans les prochains mois : celle sur la fast fashion, est espérée « avant l’été », et celle sur l’impôt plancher pour les ultra-riches. La première a été plusieurs fois reportée depuis la dissolution. Elle doit être présentée « avec des mesures renforcées », empêchant les « effets de bord qui pénaliseraient nos entreprises » selon la ministre déléguée au Commerce. Inspirée d’une proposition de l’économiste Gabriel Zucman, la loi visant à instaurer un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des « ultra-riches », a elle été adoptée à l’Assemblée le 20 février. Mais son adoption au Sénat paraît plus complexe.
Illustration : Canva

